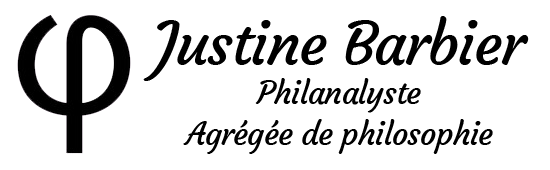L’éducation est-elle en crise ?
Je n’ai rien trouvé de mieux que les analyses d’Hannah Arendt pour expliquer la crise de l’autorité. Cette crise de l’autorité, elle n’est finalement rien de moins que l’avènement de la pédagogie. Reprenons depuis le début. Les enfants, les adolescents, ne reconnaissent pas l’autorité des adultes, ne la considèrent pas comme légitime. Ils décident alors de se soumettre à quelque chose de redoutable : la tyrannie de la majorité, la tyrannie du groupe. En découle deux conséquences elles-mêmes redoutables : le conformisme, ou bien l’autre extrême : la délinquance, la rébellion. Le maître en sait à peine plus que ses élèves, nous dit Arendt, car il a tout misé sur la pédagogie ; il est presque devenu une machine à enseigner. Il y a là quelque chose de grave, car on tarit la source même de l’autorité : le savoir. Et c’est ce même savoir qui n’est pas reconnu aux parents, aux générations qui précèdent la jeune génération, au temps passé. Le passé, c’est périmé : l’âge est un crime, comme l’a écrit Dino Buzzati. La boucle est bouclée. Ce qu’a montré Arendt, c’est que notre crise est une crise de l’éducation. Elle est remontée à la source. Il faut aux enfants des tuteurs, comme les plantes, pour que la culture (dans tous les sens du terme) les reconduise à leur essence. Et s’il n’est pas folie de vouloir corriger les enfants pour les conduire vers eux-même, et pour leur permettre de devenir ce qu’ils sont, est-ce vraiment « une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler à corriger le monde » (Molière, Le Misanthrope) ? Corriger, mais aussi célébrer. N’oublions pas que les premières tragédies ont été écrites pour des fêtes religieuses, en l’honneur du dieu Dionysos. Quand la lourdeur du destin se mêle à la célébration, il est facile d’y déceler des Fleurs du mal. A ce sujet, je me disais que l’état d’abattement qui caractérise le Spleen devait être aussi présent que l’Absolu chez Baudelaire, parce que « le manque de quelque chose qui n’existe pas » qui l’assaille, créé à la fois son paradis et son enfer. Pendant que Nietzsche est « assailli par l’espoir », Baudelaire est assailli non par rien, mais bien par quelque chose qui n’existe pas, qui crée un béance, qui manque, qui n’est pas là. Bientôt, nous manquerons tous de quelque chose qui n’existe pas, et ce sera notre paradis et notre enfer. D’ici cinquante ans, au rythme actuel, les réserves trouvées de pétrole se seront taries, et le monde sera à réinventer. A moins qu’un huitième continent de plastique, comme un désastre désertique, tout sauf un art, ne vienne peupler la vacuité, les océans fatigués et les mers dévastées. Si ça continue, je vais m’évanouir. Mais comme dans Une charogne, écrit par notre prince poétique, s’évanouir, ce n’est pas très éloigné de s’épanouir : je suis donc à la croisée de ma destinée. Et si « chaque génération se croit vouée à refaire le monde, la mienne (cependant) sait qu’elle ne le refera pas ; mais sa tâche est peut-être plus grande : elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse » (Camus) ; et l’artiste réunira ce qui se décompose, rassemblera ce qui est éparpillé, cet inouï épanoui évanoui.
Je vous souhaite une semaine loin de toute pédagogie, sans conformisme, et riche de l’autorité du savoir, où vous seriez des plantes reconduites à leur essence. Une semaine où vous célèbreriez Dionysos, et où le mal accoucherait de merveilleuses fleurs. Une semaine où vous ne manqueriez de rien, et où chaque seconde réinventerait le monde.